Dimanche 28 juin 2015 : Alexis Tsípras, Premier ministre grec, annonce à la télévision nationale la fermeture temporaire des banques après la rupture des négociations entre Athènes et ses créanciers. Quatre jours avant, il déclarait son intention de soumettre au référendum national le plan de réformes initial proposé par l’Union Européenne (UE), la Banque Centrale et le Fonds Monétaire International. Sur Twitter, les premières réactions sont vives : le #ThisIsACoup, relayé notamment par les économistes Paul Krugman et Joseph Stiglitz, dénonce un coup d’État politique de la part des institutions européennes destiné à faire plier Tsípras et faire gagner le « oui ». Dans toute la Grèce, les distributeurs automatiques de billets sont pris d’assaut. La population est à bout : depuis 2008, le PIB grec a perdu 20% de sa valeur, un niveau rarement atteint par une économie européenne depuis la Première Guerre mondiale. À la veille du référendum, les billets de 10€ et de 20€ commencent à manquer. Le 5 juillet 2015, le « non » l’emporte à 61,3%. Malgré l’indéniable victoire politique de son camp, Alexis Tsípras maintient des mesures d’austérité en Grèce et annonce la démission de son gouvernement le 20 août 2015.
Deux ans se sont écoulés depuis cet épisode. Encore aujourd’hui, les grecs subissent les conséquences de l’austérité. Derrière ce mot se cache néanmoins une réalité bien plus complexe et malheureusement difficile à saisir dans sa globalité pour quiconque ne l’a pas réellement vécue. Les effets de la crise sont pourtant visibles : outre les commerces fermés, le chômage est encore omniprésent et les familles sont obligées de se soutenir financièrement. Le « non » au référendum du 5 juillet 2015 n’était donc pas le « non » d’un peuple qui refusait de payer pour les erreurs passées mais bel et bien le « non » d’un peuple qui n’avait plus rien à donner à ses créanciers. Ce « non » apparaissait alors comme le dernier recours d’un pays au bord du gouffre qui tentait de préserver sa dignité. Que dire alors de l’espoir suscité par sa victoire et de la déception immédiate qui a suivi la capitulation de Tsípras face à la Troïka ?
Les grecs sont aujourd’hui résignés et préfèrent supporter le poids de l’austérité plutôt que d’être confrontés à nouveau à la fermeture de leurs banques. Ils pensent que ce référendum n’a servi à rien, si ce n’est à confirmer une fois de plus le ressenti d’une absence de démocratie au sein de l’Union européenne. La population a perdu tout espoir non seulement en ses dirigeants, desquels elle attendait la fin de l’austérité, mais aussi en l’Europe elle-même, qui semble n’avoir plus de grec que l’étymologie de son nom. De mes yeux, j’ai observé la déliquescence de cet espoir parfaitement orchestrée par les instances européennes. En tant que grec, j’aurais toutes les raisons de dénoncer une Union européenne anti-démocratique, corrompue et gouvernée par les banques pour me tourner vers les solutions politiques prônant sa dissolution. Pourtant, aujourd’hui plus que jamais, je crois en l’Europe. Je crois en l’Europe d’abord parce qu’elle n’est pas qu’une entité abstraite, restrictive et sans emprise sur nos vies comme on aimerait parfois nous le faire croire : son impact est réel dans plusieurs domaines majeurs, à commencer par l’éducation. Le programme ERASMUS, qui fête lui aussi son anniversaire, a ainsi permis à plus de trois millions d’étudiants européens depuis 1987 de recevoir un soutien financier pour vivre une expérience à l’étranger. L’Europe agit également de manière décisive au niveau environnemental. Sous son influence, les États membres ont adopté des mesures cruciales pour la sauvegarde de l’environnement ne serait-ce que dans le cadre des quotas d’émission de CO2 ou de la directive REACH sur les risques liés aux substances chimiques. La monnaie commune, contestée notamment par le Front National en France, nous garantit quant à elle une stabilité des prix sans conteste en nous immunisant contre la spéculation sur les taux de changes des monnaies nationales.
Si les critiques de l’Union Européenne sont parfois justifiées, faire de cette-dernière la raison de tous nos maux est un mensonge. Jeudi dernier, à l’occasion de la sortie de son essai Les Salauds de l’Europe, Le journaliste Jean Quatremer déclarait ainsi sur le plateau de Quotidien que « les États ont tendance à européaniser les échecs nationaux et à nationaliser les succès européens » ; un constat que les déclarations des nombreux candidats eurosceptiques à l’élection présidentielle française – Marine Le Pen en tête – ne cessent de confirmer.
« Je crois enfin en l’Europe en tant qu’idéal »
Un idéal qui doit aujourd’hui être refondé bien plus qu’il ne doit être préservé. Pendant trente ans les dirigeants européens et notamment français, ont affirmé que « l’Europe était la solution » tout en menant des politiques qui ont creusé un fossé entre les aspirations de ses citoyens et la réalité du projet européen.
Aujourd’hui, il appartient aux peuples de se ressaisir de ce projet : sceller un avenir commun autour de réelles valeurs démocratiques, sociales et économiques. Ces valeurs doivent être au centre d’un plan de réformes ambitieux des institutions de l’Union européenne, sans quoi sa dislocation deviendra inévitable. Ainsi, pour remplacer l’Eurogroupe, véritable institution fantôme dont l’opacité et l’importance – particulièrement lors de la crise grecque – lui ont déjà valu un bon nombre de critiques, l’idée d’un parlement de la zone euro se développe timidement, notamment au sein de la campagne présidentielle française. L’intérêt d’une réforme des institutions est double : au-delà de l’apport démocratique, il s’agit aussi de légitimer le modèle européen dans des mentalités encore dubitatives quant à son importance. Dans un monde à 7,4 milliards d’habitants, nul doute que la France (66 millions d’habitants) et l’Allemagne (80 millions d’habitants) doivent compter sur l’Europe (500 millions d’habitants) ainsi que sur sa puissance économique pour faire entendre leurs voix, d’autant plus que ce même projet européen est amené à jouer un rôle majeur dans le cadre d’une future gouvernance mondiale.
Mais pourquoi défendre cet avenir commun que d’aucuns qualifient d’utopique ou d’obsolète ? Peut-être par nécessité. Je n’ai pas envie que ma génération n’envisage son futur qu’à travers le prisme du discours nationaliste, identitaire et protectionniste, aujourd’hui dominant. Notre rapport au monde ne peut-être le même que celui de nos parents. Ce qui est important aujourd’hui c’est de faire entendre notre voix, de ne pas douter de ce que le projet européen reste avant tout le nôtre, au-delà des politiques menées, des crises à traverser et des difficultés à surmonter.



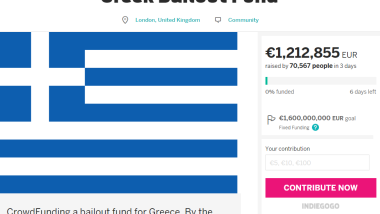

Suivre les commentaires : |
|
